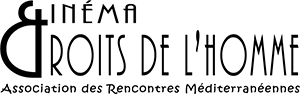La première rencontre d’échange sur la politique publique relative au cinéma marocain organisée par l’ARMCDH
Trois vocables ont marqué la rencontre : « l’absence », le « manque » et la « divergence »
L’Association des Rencontres Méditerranéenne du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) a organisé une rencontre d’échange sur la politique publique relative au cinéma marocain, le 20 janvier 2022 à l’Hôtel Tour Hassan à Rabat.
La rencontre très restreinte, vu les circonstances d’état d’urgence sanitaire, avait pour objectifs d’écouter les différents intervenants.es dans le domaine du cinéma pour répondre à une question principale : jusqu’à quelle mesure la politique publique du cinéma est conforme aux dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’Homme ?
Le débat de la rencontre, qui a connu la participation d’une trentaine de participants .es, représentants.es les différents secteurs du monde du cinéma, en format hybride à la fois en présentiel et en ligne, a fait ressortir les constats préliminaires suivants :
- Le cinéma constitue un vecteur de promotion des droits de l’Homme ;
- Le cinéma est au cœur du débat national sur la liberté d’expression ;
- L’image a un pouvoir incommensurable aussi bien sur les sociétés que sur les Etats ;
- Nous vivons une réalité qui reste encore fragile par rapport aux mutations politiques et sociales aux niveaux national et international ;
- Le cinéma et les droits de l’Homme ne signifie en aucun cas limiter la liberté artistique par les lois, mais il s’agit de garantir lesdits droits dans la gestion et la gouvernance de l’industrie cinématographique nationale ;
- La situation des professionnels du cinéma mérite aussi un débat de fond ;
- Les programmes de formation se focalisent davantage sur la technicité de production cinématographique.
- Trois vocables/expressions ont marqué cette rencontre : « l’absence », le « manque » et la « divergence » ;
Les participants.es ont abordé plusieurs remarques sur le secteur du cinéma, autour de 7 :
1. La conformité des lois avec le cadre normatif des droits de l’Homme et avec l’esprit de la Constitution de 2011
– La constitution de 2011 devrait le réfèrent pour toute réflexion juridique sur la liberté d’expression ;
– L’absence d’une vraie communication et un vrai dialogue entre les professionnels du cinéma et le législateur ;
– Toute réforme du texte législatif doit intégrer le principe d’égalité (entre les sexes) comme principe transversal ;
– L’absence de conventions collectives qui pourraient garantir les droits des professionnels ;
– Le Manque de connaissance des lois par les professionnels du Cinéma sachant que ces lois ne sont pas claires ;
– La nécessité d’examiner la loi qui régit le CCM par des experts.es confirmé.es pour permettre aux professionnels d’approfondir le débat.
2. Exercice des libertés
La question de la censure à tous les niveaux et sous différentes formes confondues : de l’autocensure, censure du scénario, fond d’aide et exploitation/diffusion, aux autorisations de tournage, notamment pour le documentaire aux visa d’exploitation et visa culturels, est pratiquée à la fois par l’administration et par les commissions. Elle est ambiguë, n’existant pas dans les textes, mais dans la pratique et la culture des acteurs qui interviennent dans le domaine.
3. Accès à l’information, aux archives
La question de la difficulté d’accès aux archives a été soulevée également étant la plus grande entrave de réhabiliter la mémoire collective, le manque de réponse, les délais d’attentes ont été les plus gros problèmes signalés, sans parler de l’état des archives. Parlez d’accès aux archives passe d’abord par la préparation des accès.
4. La gouvernance
Sur le volet gouvernance, c’est l’autorisation de tournage qui a pris la part du loup dans les interventions des acteurs. On a signalé une discrimination la base du genres cinématographiques (inégalité de traitement entre le filme fiction et le documentaire). Les délais de réponses qui peuvent atteindre plus d’une année, et aussi le flou sur la responsabilité effective relative à l’autorisation, notamment pour le documentaire.
Également la question de la logique et la pratique d’octroi de la carte professionnelle qui posent beaucoup d’interrogation.
D’un autre côté, les intervenants.es ont abordés la problématique des critères de mise sur pied des commissions et les modalités de leur travail (les PV de commissions ne présentent que les décisions, sans justification, ni compte rendu sur les problématiques rencontrés pouvant être la base d’une réflexion pour la réforme du secteur). La question s’est également posée sur le double statut du CCM, en tant que producteur et régulateur.
5. La question de l’égalité des représentations discriminantes pour les femmes
La question de l’égalité à la fois dans l’accès aux différents dynamiques de gouvernance du domaine ainsi qu’à l’accès aux fonds d’aide a été également soulevée, en plus de l’existence de stéréotypes sexistes qui ne permettent pas de faire évoluer l’image de la femme dans la société. Si l’audiovisuel s’est doté de cahier des charges permettant de réguler et de condamner ces représentations, le cinéma n’arrive pas à le faire, sous prétexte d’une certaine ‘liberté d’expression’. Le changement de cet aspect devrait partir de la conscience des acteurs dans le domaine.
6. La formation des professionnels
Les participants.es ont signalé, l’absence de la composante « droits humains » dans les programmes de formation des universités et des écoles de cinéma. La formation est purement technique marquée par le manque de formation éthique, culturelle et polyvalente incluant les sciences humaines.
7. Le droit à la culture :
Enfin, les différentes interventions ont signalé, que ce débat se fait loin de la cible du cinéma, qui sont les citoyens et les citoyennes vu l’absence à la fois d’infrastructure d’accès aux films, et de la culture de cinéma de manière général. Il y a un grand effort à faire pour le développement des infracteurs culturelles et cinématographique.
Cette première rencontre a été une première rencontre d’échange pour être à l’écoute des acteurs, elle se veut pour l’ARMCDH une étape importante d’identification des priorités des acteurs, pour l’élaboration d’un rapport annuel sur la politique publique du cinéma à travers une approche droits de l’Homme.
Cette rencontre est organisée dans le cadre du nouveau projet ‘ Plaidoyer pour les droits de l’Homme : le cinéma pour la réforme des politiques publiques et réforme de la politique publique du cinéma au Maroc’ financé par l’Union Européenne. Ce projet s’articule autour de 4 axes phares :
- Appui à la société civile dans le plaidoyer sur de questions de droits humains
- Préparation à la réinsertion des détenus mineurs
- Contribution à la réforme des lois e de la politique publique relative au cinéma
- Plaidoyer pour a réforme des politiques relatives aux droits humains et au cinéma
Il a pour objectifs d’inscrire le cinéma comme support et comme objet de la bataille culturelle et politique pour les droits humains et l’Etat de droit au Maroc ; de consolider et renforcer le rôle de la société civile dans le plaidoyer et de dynamiser le partenariat pluri acteurs dans la promotion et la défense des droits de l’Homme